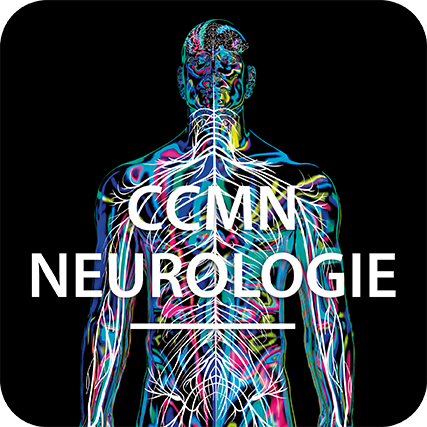Epilepsie
Lépilepsie ?
QU’EST-CE QUE L’ÉPILEPSIE ?
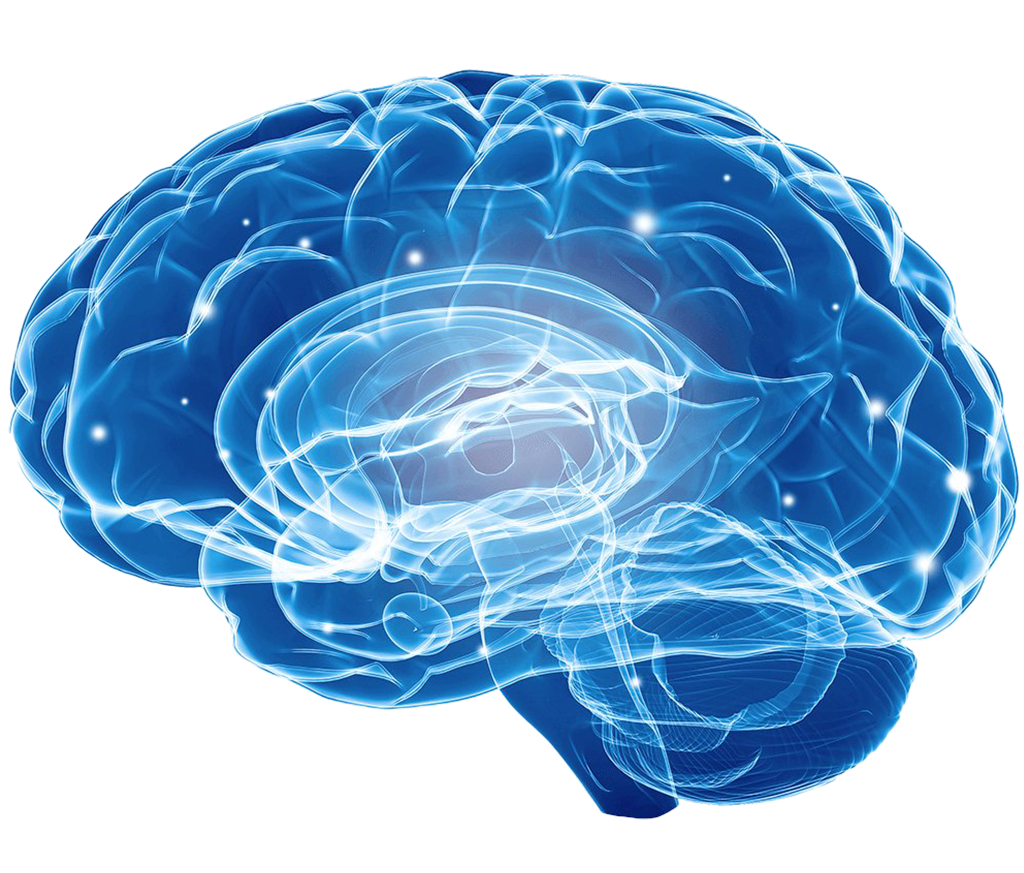
Le mot « épilepsie » vient du grec « epilambanein » qui signifie « attaquer par surprise ». Ce n’est pas une maladie mentale, bien qu’elle fasse encore l’objet de beaucoup de croyances et de préjugés.
L’épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée de crises provoquées par l’hyperactivité extrême d’un groupe de neurones (cellules nerveuses) dans le cerveau. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée et leurs manifestations ne sont pas toujours celles qui viennent spontanément à l’esprit lorsqu’on évoque cette maladie.
Une seule crise de type épileptique ne suffit pas pour dire qu’une personne souffre d’épilepsie. Il n’est pas rare que ce type de crise survienne une seule fois chez une personne et ne se reproduise jamais. Dans ce cas, la personne ne souffre pas d’épilepsie. Seule la répétition des crises permet de définir une épilepsie.
L’épilepsie est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. Elle peut provoquer des crises de convulsions parfois impressionnantes.
Pourtant, l’épilepsie est une maladie peu sévère pour environ les trois-quarts des personnes qui en souffrent.
Le diagnostic et le traitement de l’épilepsie ont fait des progrès considérables : aujourd’hui, avec un traitement équilibré et bien suivi, une personne épileptique peut mener une vie normale à condition de respecter certaines règles.
L’épilepsie peut cependant avoir des répercussions psychologiques et sociales, notamment chez les enfants.
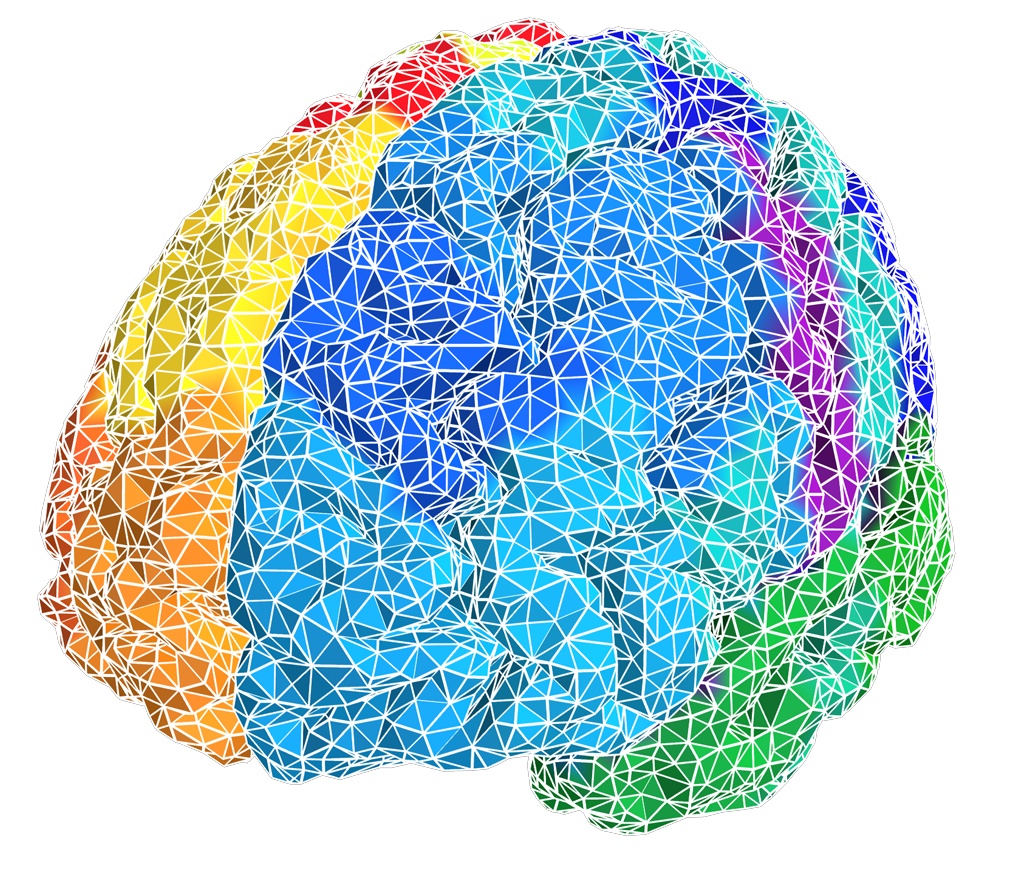
QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU LORS D’UNE CRISE D’ÉPILEPSIE
Le cerveau est constitué de cellules nerveuses, appelées neurones, qui communiquent entre elles par des signaux chimiques et électriques.
Lorsqu’un groupe de neurones est soudain, pour une raison ou une autre, le siège d’une activité électrique excessive et désorganisée, cette activité électrique va se propager aux zones du cerveau avoisinantes, voire à l’ensemble du cerveau. Tout se passe comme si le cerveau, soudain soumis à une sorte d’orage électrique, cessait de fonctionner normalement : c’est la crise d’épilepsie. Après quelques minutes, l’orage se calme et la crise d’épilepsie cesse.
Selon la zone du cerveau où se produit cette hyperactivité électrique, les symptômes seront différents. L’épilepsie est dite « partielle » ou « focale » (du latin focus : foyer) lorsqu’une partie seulement du cerveau est l’objet de cette activité électrique excessive. L’épilepsie est dite « généralisée » lorsque l’ensemble du cerveau est touché.
QUI EST TOUCHÉ PAR L’ÉPILEPSIE ?
On estime qu’il y a environ 450 000 personnes épileptiques en France (soit dix fois moins que les quatre millions de personnes souffrant de migraines). Près de 40 millions de personnes souffrent d’épilepsie à travers le monde, avec une légère prédominance masculine.
L’épilepsie peut débuter à tout âge. Elle apparaît cependant plus fréquemment aux âges extrêmes de la vie, chez l’enfant et chez les personnes âgées. Plus de la moitié des épilepsies commencent pendant l’enfance : chaque année, environ 4 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chez l’enfant.
Chez les seniors, l’épilepsie peut être provoquée par des lésions du cerveau, par exemple à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’une tumeur. Cependant, pour près de la moitié des cas d’épilepsie chez la personne âgée, aucune cause précise n’est retrouvée.
Lorsque le traitement est bien supporté, ces épilepsies sont de faible gravité. Cependant, la mauvaise tolérance des traitements antiépileptiques reste le problème principal chez la personne âgée, le plus souvent à cause d’autres maladies ou d’autres traitements qui compliquent la prise en charge de l’épilepsie.

LES CRISES D’ÉPILEPSIE PARTIELLES :
QUE FAIRE FACE À UNE CRISE D’ÉPILEPSIE ?
Il est impossible d’arrêter une crise qui a débuté et il faut donc la laisser passer en apportant son soutien au patient.
- Placer la personne en position latérale de sécurité dans un espace dégagé pour éviter les risques de blessure.
- Desserrer ses vêtements, lui placer si possible un vêtement replié sous la tête, lui enlever si besoin ses lunettes, rester auprès d’elle et la laisser récupérer après la crise.
- Il peut être intéressant pour le médecin de noter la durée de la crise.
- Transporter la personne, sauf si elle se trouve dans un lieu dangereux.
- Gêner ses mouvements.
- Lui donner des médicaments ou à boire pendant la crise.
L’idée selon laquelle la personne peut avaler sa langue et s’étouffer est fausse, ne mettez pas vos doigts dans sa bouche, car il y a un risque certain de morsure.
Ce n’est pas forcément nécessaire si l’on sait que la personne est épileptique. Par contre, cela est fortement recommandé :
- si la crise dure plus de cinq minutes,
- si elle se répète sans retour à la normale dans l’intervalle,
- si la personne ne reprend pas conscience dans les dix minutes,
- si elle s’est blessée.
LES CRISES D’ÉPILEPSIE GÉNÉRALISÉES :
Les crises d’épilepsie sont dites « généralisées » lorsque l’hyperactivité électrique s’étend de sa zone d’origine à l’ensemble du cerveau. On distingue quatre types de crises d’épilepsie généralisées. Certaines personnes épileptiques ressentent des symptômes annonciateurs de la crise qui vient : ce phénomène d’ « aura » peut se traduire par des hallucinations, de la nervosité ou de l’irritabilité, un sentiment de peur ou des impressions de « déjà-vu ».
Les absences, autrefois appelées « petit mal », touchent essentiellement les enfants entre cinq et douze ans. Il s’agit d’une crise d’épilepsie sans convulsion : la personne perd le contact avec son entourage pendant quelques secondes, son regard est dans le vague et elle peut cligner des paupières. Ce phénomène peut se répéter plusieurs fois par jour ou, parfois, par heure. Les parents et les enseignants pensent parfois que l’enfant est un rêveur souvent dans la lune.
Les crises tonico-cloniques sont celles qui viennent à l’esprit lorsqu’on pense à l’épilepsie. Également autrefois appelées « grand mal », elles se traduisent par une perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l’apparition de bave au bord des lèvres (les mâchoires sont contractées et la personne ne déglutit plus) et, parfois, des vomissements, une perte d’urine ou de selles, ainsi qu’un bref arrêt de la respiration qui provoque une cyanose (la personne bleuit).
Ce type de crise est impressionnant pour l’entourage et peut être à l’origine de blessures provoquées par la chute et la perte de connaissance. Le plus souvent, la crise s’arrête d’elle-même en moins de deux minutes.
En termes médicaux, c’est une crise généralisée tonico-clonique, car elle comporte deux phases : elle enchaîne une période de contraction musculaire intense (phase tonique) et une période de convulsions (phase clonique). Lorsque la personne reprend conscience, elle est désorientée, fatiguée et éprouve un fort besoin de dormir.
Les crises dites « myocloniques » se traduisent par des secousses musculaires brusques et répétées, au niveau des bras et des jambes, survenant essentiellement au réveil ; la personne s’en rend compte et peut lâcher des objets ou tomber. Cette forme de crise s’observe par exemple chez un adolescent qui renverse, de façon involontaire, son verre de jus de fruit ou son bol de chocolat au petit déjeuner.
Plus rares, les crises atoniques se traduisent par une perte soudaine de tonus musculaire. La personne s’affaisse sur elle-même pendant quelques secondes, puis se relève et peut recommencer à marcher sans problème.
Nous savons prendre soin de vous !
Chez CCMN, nous nous efforçons toujours de vous apporter l’aide qu’il vous faut avec un grand engagement et patiente.

Chez les enfants, les épilepsies généralisées sont également :
- soit idiopathiques (épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson, épilepsie absence de l’enfant, épilepsie myoclonique juvénile et épilepsie grand mal du réveil),
- soit non idiopathiques (épilepsie myoclono-astatique et syndrome de Lennox-Gastaut).
Lorsqu’un enfant souffre d’épilepsie partielle, celle-ci est parfois dite « idiopathique bénigne », c’est-à-dire sans cause identifiable au niveau du cerveau.
Les plus fréquentes de ces formes d’épilepsie sont l’épilepsie à paroxysmes rolandiques et l’épilepsie occipitale bénigne précoce. Elles sont peu invalidantes et ne justifient pas de traitement dans la plupart des cas, sauf si elles sont trop fréquentes, si elles surviennent dans la journée, ou si elles perturbent la vie quotidienne de l’enfant.
Les autres épilepsies partielles de l’enfant, dites « non idiopathiques », peuvent être mises en relation avec une activité électrique anormale d’une région particulière du cerveau. Elles justifient la mise en place d’un traitement.
Le diagnostic de l’épilepsie n’est pas toujours aisé et se fait à l’aide de :
- l’interrogatoire du patient et des proches : première crise, circonstances, description et durée, fréquence des crises suivantes, antécédents médicaux, etc.
- l’examen clinique de la personne, ainsi que la recherche d’éventuels facteurs favorisants ;
- l’électroencéphalogramme (EEG) : cet examen permet d’obtenir un tracé de l’activité électrique du cerveau. Lors d’épilepsie, des anomalies caractéristiques peuvent être mises en évidence, entre les crises, de façon permanente ou intermittente : on parle de pointes ou de pointes ondes présentes dans certaines régions du cerveau.
La recherche des causes d’une épilepsie se fait essentiellement grâce aux techniques d’imagerie médicale telles que le scanner (plutôt réalisé lors de la première crise) ou l’IRM (imagerie par résonnance magnétique) qui permettent de visualiser les structures du cerveau. Leur utilisation n’est cependant pas systématique. L’IRM reste l’examen de référence pour la recherche des causes de l’épilepsie.
D’autres examens (prise de sang, examen du fond d’œil, par exemple) peuvent être utiles dans la recherche de certaines causes.
L’électroencéphalogramme (EEG) est un examen non douloureux, réalisé à l’aide d’une quinzaine d’électrodes placées sur le cuir chevelu, sur des régions précises du crâne. L’activité électrique des neurones est enregistrée, amplifiée et traduite sur papier ou sur informatique. Le patient est en position assise ou allongée, l’examen peut s’effectuer chez le neurologue ou à l’hôpital, et dure environ trente minutes. Il n’y a aucune préparation particulière pour cet examen.
Un EEG comporte plusieurs phases : tracé au repos, avec ouverture et fermeture des yeux à la demande, épreuve d’hyperventilation (respiration rapide), stimulations lumineuses intermittentes à l’aide d’un stroboscope. Chez les jeunes enfants, l’examen est pratiqué pendant une période de sommeil naturel (sieste)Antiépileptiques : acide valproïque
- DÉPAKINE
- DÉPAKINE CHRONO
- MICROPAKINE LP
- VALPROATE DE SODIUM ARROW
- VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN
- VALPROATE DE SODIUM EG
- VALPROATE DE SODIUM MYLAN
La carbamazépine est utilisée dans le traitement des épilepsies partielles et généralisées. Elle présente de nombreuses interactions potentielles avec d’autres médicaments. Elle est habituellement bien tolérée. Ces effets indésirables sont le plus souvent liés à un dosage trop fort : vertiges, somnolence, trouble digestif, etc. Néanmoins, des effets indésirables plus graves sont possibles tels que des allergies cutanées ou des anomalies du sang. Il faut prendre un avis médical d’urgence en cas de rougeurs ou de boutons, de fièvre ou d’angine.
ANTIÉPILEPTIQUES : CARBAMAZÉPINE
- CARBAMAZÉPINE MYLAN
- CARBAMAZÉPINE SANDOZ
- TÉGRÉTOL
ANTIÉPILEPTIQUES : LAMOTRIGINE
- LAMICTAL
- LAMOTRIGINE ARROW
- LAMOTRIGINE ARROW LAB
- LAMOTRIGINE BIOGARAN
- LAMOTRIGINE EG
- LAMOTRIGINE MYLAN
- LAMOTRIGINE SANDOZ
- LAMOTRIGINE TEVA
ANTIÉPILEPTIQUES : OXCARBAZÉPINE
- OXCARBAZÉPINE MYLAN
- OXCARBAZÉPINE SANDOZ
- OXCARBAZÉPINE TEVA
- TRILEPTAL
ANTIÉPILEPTIQUES : GABAPENTINE
- GABAPENTINE ARROW
- GABAPENTINE BIOGARAN
- GABAPENTINE CRISTERS
- GABAPENTINE EG LABO
- GABAPENTINE EVOLUGEN
- GABAPENTINE MYLAN